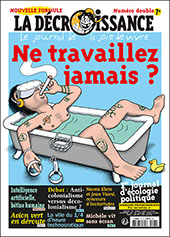Vers une économie écologiquement
et socialement soutenable.
La prospective bioéconomique
Mauro Bonaiuti*
Introduction
Le moment historique que nous vivons est sans aucun doute extrêmement
vivant du point de vue intellectuel. Dans le monde des alternatives au système
économique néolibéral on assiste à un bouillonement
extraordinaire d’idées et d’initiatives. Beaucoup d’observateurs
se posent la question: disposons-nous aujourd’hui d’une théorie
économique alternative qui sache recomposer les pièces de cet
“autre monde en construction” vers une économie écologiquement
et socialement soutenable?
Certes nous sommes devant une fresque aux tracés encore incertains,
aux figures encore incomplètes mais l’essentiel c’est que
l’on puisse déjà entrevoir une épistemologie et
la structure des relations qui existent entre les sujets principaux.
Dans la première partie de mon travail (Cf Introduzione a N. Georgescu-Roegen,
Bioeconomia, 2003), la relecture des fondements biologiques du processus économique
et de la théorie des systèmes complexes nous fournira d’abord
une assise épistémologique commune au projet pour une économie
écologiquement et sociologiquement durable.
Dans la deuxième partie j’ai essayé de fournir une représentation
analytique de ce que Ivan Illich aurait défini un équilibre
multidimensionnel du système socio bioéconomique. Elle comprend
un nouveau modèle bioéconomique du comportement du consommateur
qui, intégrée avec la théorie de la production de Georgescu-Roegen
offre une vision systèmique et multidimensionnelle du processus bioéconomique.
La troisième phase présente une analyse de la dynamique du système
socio-bio-économique. Elle permet de mettre en évidence certains
circuits potentiellement auto-destructifs propres à l’économie
néolibérale et en offre une clé de lecture commune.
Pour conclure nous présenterons des lignes d’interventions possibles
qui devraient compenser les effets destructeurs illustrés précédemment.
Elles se basent sur les expériences diverses que la société,
en s’auto-organisant spontanément, est en train de mettre en
acte (économie solidaire, défense de l’environnement,
consommation responsable, finance éthique, etc.), mais que l’approche
systèmique permet de réinterpréter comme idées
germinales dans la création d’une économie autre, écologiquement
et sociologiquement durable.
PREMIÈRE PARTIE : EPISTÉMOLOGIE
Cette première partie constitue la tentative de revoir de façon
critique l’économie standard selon certains principes fondamentaux
qui caractérisent les systèmes complexes. Ces systèmes
et en particulier les systèmes biologiques et écologiques présentent
certaines caractéristiques formelles sur lesquelles il serait bon de
s’arrêter.
A. Entropie
S’il est vrai , comme l’a démontré Georgescu-Roegen,
que toute activité économique engendre une irréversible
dégradation de matière et d’énergie en quantités
croissantes il nous faut en tirer deux conclusions importantes pour l’économie.
La première est d’ordre pratique: l’objectif qui sous-tend
l’économie moderne, la croissance économique illimitée,
s’opposant aux lois fondamentales de la nature, doit être abandonné
ou tout au moins radicalement revu. Il est clair désormais que du point
de vue thermodynamique, la décroissance est une nécessité
La seconde est de nature méthodologique: la représentation pendulaire
du processus économique qui fait l’ouverture de tous les manuels
d’économie, selon laquelle la demande stimule la production qui
elle même fournit les revenus nécessaires pour alimenter une
nouvelle demande, dans un processus réversible et à même
de se reproduire à l’infini, devra laisser le champ à
une représentation circulaire et évolutive dans laquelle le
processus économique s’intègre au mieux dans le milieu
biophysique qui le soutient. En d’autres mots, le processus économique
de production a un coût (en termes de matière/énegie dégradée)
et ce coût sera toujours supérieur à zéro. La nature,
contrairement à ce que pensaient les économistes classiques,
y compris Marx, n’offre rien pour rien
.
1) Les systèmes biologiques ne tendent à la maximalisation d’aucune variable
Si nous excluons la variable générale de la survie de l’espèce,
nous ne pouvons affirmer que les systèmes biologiques visent la maximalisation
d’un but unique auquel les autres variables seraient subordonnées.
En général, si la valeur d’une variable est trop élevée
ou trop basse elle devient dangereuse pour l’organisme: ainsi trop d’oxigène
provoque la combustion des tissus, trop peu en provoque l’asphyxie.
Il existe dans le monde biologique des seuils, (qu’ils soient flexibles
ou dans certains cas encore indéterminés) , que l’on ne
peut franchir. (Vernadskij, 1945).
Ce principe s’oppose fortement aux thèses de la théorie
économique dominante pour laquelle les comportements des sujets économiques
fondamentaux sont de type maximisant au niveau micro-économique (maximum
de profit pour les entreprises et d’utilité pour les consommateurs)
ainsi qu’au niveau macro-économique (croissance du revenu et
de la production). Le PNB qui comprend dans son calcul toutes sortes d’activités
économiques est bien plus une prise de température du système
économique qu’une représentation de l’indice du
bien-être des individus. Stimuler sans cesse l’augmentation du
PNB dans une société hyperindustrialisée revient à
provoquer une ultérieure augmentation de température chez un
patient déjà fiévreux.
2) Ils ont une pluralité d’objectifs
Dans le monde biologique, en particulier chez les mammifères, ceux-ci
présentent un système de valeurs multidimensionnel (Bateson,1976,
p.154; Lorenz, 1983).
Cette caractéristique contraste elle aussi avec les axiomes de la théorie
économique dominante. Certaines hypothèses spécifiques
ont été introduites pour garantir que le bien-être produit
par la consommation de n’importe quel bien puisse être ordonné
le long du même indice monodimensionnel : l’utilité.
Comme l’a démontré Georgescu-Roegen l'on ne peut utiliser
l’axe unidimensionnel pour des séries d’activités
différentes, c’est à dire lorsqu’il n’y a
pas de possibilité de substitution entre les biens . L’expérience
de tous les jours nous l’enseigne: l’accès à l’Internet
ne peut être un bon substitut pour la personne qui meurt de soif, de
la même manière que la distribution de pain de la part des associations
humanitaires ne peut remplacer le besoin de justice et de dignité de
l’individu. De nombreuses contributions provenant de diverses disciplines,
de la biologie à l’anthropologie, des sciences sociales à
la psychologie, toutes nous enseignent que l’authentique bien-être
est le résultat de nombreuses dimensions irréductibles entre
elles.
3) Les systèmes biologiques présentent une combinaison de
comportements de type compétitif et coopératif
Pour l’économiste le monde naturel est un monde caractérisé
par la présence de comportements exclusivement compétitifs.
Une lecture trompeuse de la théorie darwinienne a construit une représentation
de l’univers du vivant dominé exclusivement par la “lutte
pour la survie” et cette conception a été étendue
aux systèmes socio-économiques (le darwinisme social). Il est
intéressant de noter que a contrario la littérature biologique
soviétique ait fait état de relations coopératives, symbiotiques
entre les espèces, la compétion étant presque nulle et
la nature devenant métaphore de la coopération universelle.
Je crois que nous devons aller au-delà de ces lectures idéologiques
et instrumentales: les biologistes savent désormais que dans les écosystèmes
les comportements compétitifs et coopératifs coexistent et sont
tous les deux essentiels à la survie de l’espèce.
4) Dans un contexte expansif ce sont les comportements compétitifs
qui déterminent le succès et le développement de l’espèce
alors que dans des contextes non expansifs (d’équilibre) ce sont
les comportements coopératifs qui en déterminent le succès.
Selon Kenneth Boulding les modalités d’interaction au sein des
écosystèmes sont essentiellement au nombre de deux: l’une
fondamentalement expansive (colonizing mode) l’autre non expansive ou
d’équilibre (equilibrium mode). La première est caractérisée
par des conditions d’abondance de ressources et de nouveaux espaces.
Les organismes se diffusent vers de nouveaux écosystèmes, vers
de nouvelles niches à coloniser. Dans la deuxième, vu l’absence
de nouveaux territoires libres ou sous-exploités, les organismes s’installent
dans une position d’équilibre. La biologie nous donne une leçon
fondamentale à savoir qu’il n’y a pas de comportement univoque
mais que, bien au contraire, les stratégies qui favorisent le développement
de l’espèce s’adapteront aux mutations du contexte environnemental.
Contrairement à ce qu’affirme la théorie libérale,
“maximiser” la compétition à travers la concurrence
parfaite entre des sujets économiques ne produit pas nécessairement
les résultats optimaux. Il est probable que des sujets ou des comportements
particulièrement compétitifs soient gagnants dans des contextes
expansifs. L’homo sapiens a évolué à travers une
perpétuelle conquête et colonisation de nouveaux territoires
et cela en compétition avec d’autres espèces. Agressivité
et attitudes compétitives sont donc profondément inscrites dans
son parcours évolutif. Plus récemment, l’aventure de la
modernité (avec sa culture individualiste et compétitive) est
née et a évolué dans un contexte expansif caractérisé
par la conquête de nouveaux continents (Amérique, Indes, etc.)
et de nouveaux espaces intellectuels (sciences, techniques, etc.) Ce n’est
pas par hasard enfin que l’esprit économique américain,
particulièrement individualiste et compétitif, s’est forgé
dans l’expérience de l’expansion vers l’Ouest.
Par contre dans des conditions non expansives , qui sont celles vers lesquelles
tend nécessairement l’espèce humaine puisque les écosystèmes
terrestres sont presque tous colonisés, ce sont les comportements coopératifs
qui donnent les meilleurs résultats.
Cela nous amène à une diverse conception de la pression compétitive
dans nos systèmes socio-économiques actuels: un degré
trop élevé comme un degré trop faible de compétion
seront généralement dangereux pour le système. La nature
nous enseigne que rechercher l’efficacité à travers la
compétition exaspérée en tant qu’objectif unique
de l’activité économique, n’est pas seulement la
conséquence d’une conception réductive de l’être
humain mais que c’est aussi, comme nous le verrons, une voie vers des
comportements destructeurs de l’espèce. De nouvelles formes d’esclavage,
la destruction de l’environnement, la diffusion de la corruption financiaire,
peuvent représenter des exemples de ces effets desctrucifs (cf. 3e
partie).
5) Dans un contexte non expansif, un certain degré de compétition
entre espèces différentes favorise le développement des
écosystèmes, au contraire la compétition entre des membres
d’une même espèce (compétition intraspécifique)
nuit généralement et réduit donc la possibilité
de survie de l’espèce même.
Pourquoi, dans le long parcours de l’évolution, l’action
de la pression compétitive entre les espèces a-t-elle produit
une incroyable expansion de la biodiversité alors que dans le contexte
économique global, la pression compétitive semble engendrer
uniformité et perte de diversité? La réponse à
cette question pourrait se résumer dans le fait que dans la nature
la compétition se fait principalement entre des espèces différentes
alors que dans le système économique global la concurrence se
fait entre produits et technologies semblables.
Imaginons un marché oligopolistique mûr, dans lequel on produit
un bien homogène, dont la demande est constante ou en déclin.
Dans ce marché opèrent certaines grandes entreprises dont le
but est de maintenir ou d’étendre ses parts de marché.
Nous nous servirons du cas de la société Nike dont tout le monde
a désormais entendu parler pour illustrer notre propos. En avril 1998,
la multinationale, leader du secteur, a été citée en
justice pour avoir caché les résultats d’un rapport présenté
par une société de consultation sur les conditions de travail
dans les usines qui fabriquaient leurs chaussures. Le rapport disait entre
autres que «dans certains ateliers de l’usine Tae Kwang Vina,
les travailleurs étaient exposés à des substances cancérigènes
dans une proportion 177 fois plus élevée que celle permise par
la loi et que 77 % des salariés souffraient de problèmes respiratoires».
Il faut se rappeler qu’en Indonésie, où était soumissionnée
une bonne partie de la production Nike, les ouvriers travaillent en moyenne
270 heures par mois en échange d’un salaire d’environ 40
dollars (15 centimes de l’heure), qui suffit à peine à
couvrir 30% des besoins vitaux d’une famille de quatre personnes. Globalement,
le coût du travail dans les usines de chaussures grevait sur le prix
du produit fini pour moins de 0,2%.
Qu’est-ce qui pousse donc une multinationale multimilliardaire à
écraser le coût du travail à ces niveaux paroxystiques
en risquant de compromettre son image si ce n’est la peur ou plutôt
l’assurance que si ce n’est pas elle ce seront ses rivales qui
le feront? Pourquoi est-elle disposée à payer 20 milions de
dollars par an à une star de l’athlétisme qui lui prêtera
son image dans les spots publicitaires (cette somme représente un redoublement
des salaires pour tous les travailleurs indonésiens) si ce n’est
la course vers le maximum de dépenses publicitaires poussée
par la compétition positionnelle?
L’effet d’une sélection intraspécifique exaspérée,
est donc toujours, à long terme, celui de favoriser les “pires”.
Il est évident que dans cette course au rabais celui qui réussira
à exploiter plus et mieux les travailleurs, qui réussira à
payer moins d’impôts ou à éluder les contrôles
sur l’environnement sera favorisé dans la dynamique compétitive.
Les cas que l’on pourrait rapporter sont infinis et l’affilage
des dynamiques compétitives liées au processus de globalisation
offre continuellement de nouveaux exemples.
Au contraire un certain niveau de compétition entre sujets différents,
c’est à dire qui utilisent différentes formes d’organisation
du travail ou différentes technologies (des entreprises d’économie
solidaires par exemple) favorise l’augmentation de la différence
donc de la richesse sociale et économique.
6) Les systèmes complexes sont dotés d’un anneau de
rétroaction (feedback)
Il s’agit d’un aspect d’une importance fondamentale. Nous
avons des systèmes à rétroaction positive ou négative
selon que l’effet rétroactif renforce ou atténue l’input
originel. L’évolution dans le temps de ces deux typologies, sera,
on le sait, diamétralement opposée. Alors que les systèmes
à rétroaction positive présentent des caractéristiques
explosives, les systèmes dotés d’un anneau de rétroaction
négative sont autocorrecteurs. La progression exponentielle de la population
ou la spirale de la violence représentent de bons exemples du premier
type. Les ststèmes biologiques et écologiques non perturbés
représentent des exemples du second type. Il est intéressant
de noter que les organisations complexes comme les entreprises, les églises
ou les associations écologistes présentent des modalités
de comportement analogues. Des variations du milieu extérieur comme
par exemple une nouvelle norme écologique ou une innovation technologique
provoqueront des modifications dans la structure interne de l’entreprise
afin d’assurer cette variable complexe qu’est la “survie
de l’organisation”... La science économique traditionnelle
ne saisit pas ces anneaux de rétroaction parce qu’elle tend,
suivant la mécanique, à expliquer les phénomènes
selon des chaînes linéaires basées sur le principe de
cause à effet. Inversement saisir la présence de ces anneaux
est d’une importance fondamentale pour déterminer les potentielles
dérives autodestructrices du système économique et pour
comprendre en général les dynamiques évolutives de longue
période dans la relation entre système économico-social
et biosphère.
TROISIEME PARTIE : LA DYNAMIQUE EVOLUTIVE
Le faisan-argus et la spirale des revenus
Je voudrais analyser à présent les possibles transformations
évolutives du modèle. L’approche systémique signifie
à mon sens, mettre en évidence en premier lieu les relations
circulaires qui peuvent mener le système vers une spirale qui s’auto-accroît.
Il faut donc saisir les principaux circuits rétroactifs en mesure d’expliquer
ce phénomène paradoxal qui fait que l’homme occidental
dans sa recherche du bonheur et du bien-être ne trouve en réalité
que pauvreté croissante, marginalisation, guerres et différentes
formes de malaise social.
Lors de la parade nuptiale les plumes maîtresses du faisan-argus
mâle (Argusianus argus) sont dirigées vers la femelle et exhibées
dans toute leur majesté, dans la même attitude que celle du paon
qui fait la roue. Il a été démontré que le choix
du compagnon incombe exclusivement à la femelle voilà pourquoi
les possibilités de reproduction du faisan-argus sont étroitement
liées à la capacité de stimulation sexuelle et donc à
la majesté de sa livrée nuptiale. C’est la raison pour
laquelle, les plumes maîtresses de cet oiseau ont subi au cours de son
évolution un allongement progressif le menant à une situation
paradoxale: il lui est presque impossible aujourd’hui de voler.
Ce cas rapporté par Konrad Lorenz dans Les huit péchés
capitaux de notre civilisation est un excellent exemple de rétroaction
positive: la compétition entre des membres d’une même espèce
(sélection intraspécifique) déclenche un processus exponentiel
qui, sans intervention régulatrice, se concluerait par l’extinction
de l’espèce.Dans ce cas particulier le circuit régulateur
(feedback négatif) est représenté par les prédateurs
qui en éliminant les sujets les plus “exhibitionnistes”
limitent la croissance continue des plumes maîtresses. Ce cas représente
également une splendide métaphore du rôle de la technologie
dans le cadre des économies occidentales. Elle présente le même
caractère hypertrophique et est le fruit d’un analogue procesus
de rétroaction positive.
On pourrait dire que toute la rationalité économique occidentale
s’inspire du principe et de la praxis de l’efficacité.
L’économie que l’on enseigne dans les universités
occidentales découle de cet unique principe fondamental: l’efficacité.
Elle pousse les entreprises à minimiser les coûts pour maximiser
les profits. Elle permet aux entreprises de gagner la course de la dynamique
compétitive, de passer la sélection opérée par
les marchés. Ainsi les entreprises plus efficaces réalisent
de plus grands profits, ce qui leur permet de réaliser de plus grands
investissements. Plus les investissements en technologie seront importants
plus ils produiront une nouvelle efficacité. De cette manière
le processus circulaire se boucle en déclenchant un feedback positif
qui mène à un ultérieur “progrès technologique”.
C’est ce qui explique l’hypertrophisme de la mégamachine
techno-scientifique dans les sociétés modernes occidentales,
qui est encore en croissance continue.
Ce processus auto-croissant de la technologie, (étant donné
les systèmes actuels de distribution de la propriété)
porte une différentiation grandissante des revenus. En d’autres
termes, les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres toujours plus
pauvres (spirale ou fourchette des revenus). L’évidence empirique
à ce sujet est robuste. Une seule donnée pour toutes: le revenu
annuel des 225 personnes plus riches au monde dépasse la somme des
revenus annuels des 47% de la population mondiale (deux milliards 500 millions
de personnes).
Pour conclure, la dynamique systémique du progrès technologique
mène non seulement à une consistante réduction du bien-être
pour les plus pauvres et les exclus mais aussi à la diffusion de l’idée
que l’économie capitaliste est profondément injuste. Et
puisque la perception d’avoir subi une injustice structurale, plus encore
que la pauvreté même, est , à mon sens, source d’infélicité
pour tous ceux qui en ont conscience, rechercher la seule efficacité
équivaut à augmenter les différentes formes d’exclusion
et la progressive diffusion du malaise social global.
Stratégies d’adaptation et réaction
Si les processus décrits plus haut sont de nature auto-génératrice,
peut-on se demander pourquoi le système capitaliste qui se base sur
ces dynamiques, ne s’est pas encore auto-détruit mais au contraire
domine toujours le panorama économique et social global malgré
ses mille contradictions?
On sait que les écosystèmes comme les systèmes sociaux
possèdent une résilience, une capacité de cumul, autrement
dit, les spirales auto-destructrices décrites ont besoin d’un
temps que personne ne peut déterminer avant de donner lieu à
des catastrophes irréversibles. En outre il est important de remarquer
que les processus dont on a parlé donnent déjà lieu dans
différents domaines du système économique et social à
des phénomènes de réaction, d’auto-organisation
spontanée de la société civile, en fait à des
chaînes de feeback négatif qui bougent dans la direction opposée
par rapport à celles potentiellement explosives décrites plus
haut.
Il est juste à mon sens d’esquisser en conclusion certains des
processus compensatoires qui pourraient servir de “remèdes”
à l’actuelle crise écologique et sociale. Ce qui importe,
et c’est là le but de notre contribution, c’est de définir
certains critères méthodologiques généraux:
1) il faut atteindre un équilibre multidimensionnel entre
les différents systèmes (économique, biologique, social)
2) Les interventions qui compensent les dynamiques auto-croissantes (en respectant
l' équilibre multidimensionnel cité au point numéro 1)
va dans le bon sens.
Le premier point illustre le sens authentique de la décroissance. La
décroissance est nécessaire non seulement pour respecter l’équilibre
de la biosphère (les indicateurs à ce propos sont déjà
disponibles et concordants, mais aussi pour limiter les dommages sociaux du
développement et accroître le bien-vivre (o "bien
vivir," E. Mance, 2001).
La décroissance signifie surtout réduction des dimensions des
différentes institutions et organisations qui gèrent la production,
les multinationales, les organisations financières et en général
les dimensions des marchés et des organisations productives. Les écosystèmes
ne sont pas indifférents au problème d’échelle.
Cela est indispensable pour atténuer les dynamiques de l’aliénation
(au nord) et du déracinement (au sud) et pour favoriser la naissance
d’une société conviviale, c’est-à-dire respectueuse
de l’autonomie personnelle des sujets (Illich, 1974).
La réduction des dimensions des instruments de la méga-machine
comportera probablement une perte d’efficacité mais certainement
une consistante augmentation du bien-vivre. A ce propos nous ne pouvons éluder
la nécessité d’élaborer de nouveaux indicateurs
de bien-être, ou mieux de bien-vivre, alternatifs au PNB. Des
indicateurs ont été élaborés, en grand nombre,
mais il leur manque une solide et commune référence théorique.
L’un des objectifs de cette association pourrait être celui de
suggérer certains critères de base pour une évaluation
du bien-vivre dans une société conviviale. Ils accompliraient
une tâche indispensable dans une société de la communication,
à savoir celle de restituer le sentiment collectif de la perte de bien-vivre
en acte et de proposer des voies possibles. Ces indices doivent à mon
sens respecter les critères suivants:
A) le caractère multidimensionnel du concept du bien-vivre
et donc le principe de non substitutivité entre les différents
besoins;
B) la juste évaluation des seuils au-delà desquels la consommation
de biens et de services déterminés nuit à la structure
des autres systèmes.
2) Compenser les spirales auto-croissantes
Le premier cercle vicieux que nous avons analysé est celui qui mène,
à travers le progrès technologique, de la recherche de l’efficacité
à l’augmentation des inégalités économiques
et sociales (spiral de revenus). La société civile a depuis
toujour mis au point des formes de réaction qui peuvent globalement
mitiger les effets de la polarisation de la richesse produite par le développement
économique : la formation d’un syndicat influent, un système
d’imposition progressive, la présence d’institutions d’assistance
et de prévoyance sociales.
Cependant, ces phénomènes de réaction ne doivent pas
forcément etre interprétés comme des phénomènes
positifs. Le développement d'institutions de gouvernement global, d'une
force militaire internationale, ou la croissance d'un syndicat institutionnel
dans les pays du sud-est asiatique, par exemples, ne comportent pas le passage
automatique vers une société plus conviviale, mais au contraire,
ils peuvent, en certains cas, représenter un remède plus grave
que le mal. En effet, la deuxième partie nous a fait comprendre comment
ces grandes institutions ont besoin, pour maintenir leur structure, d'une
part, d'énormes quantités de matière/énergie ,
et d'autre part, d'un très gros investissement en termes de travail
sous des formes non conviviales. Il faudra donc tenir compte à la fois
de deux critères: l'équilibre multidimensionel , et la compensation
des spirales auto-croissantes.
Par exemple les expériences variées que nous résumons
sous le nom d’économie solidaire et durable, expérimentent
des solutions économiques qui compensent les cercles vicieux de l'économie
standard à travers des formes d'organization de type généralement
convivial. L’expérience des réseaux d’économie
solidaire, par exemple en Italie la nouvelle-née RES (Réseau
d’Economie Solidaire) est particulièrement intéressante.
Je pense que l’économie solidaire peut représenter pour
le futur, un réel substitut à la consommation de biens traditionnels,
elle compense l’angoisse qui est à la base de la manière
classique de consommer et permet de s’approcher des conditions d’une
économie soutenable et conviviale. La production de biens relationnels
comporte en effet une dégradation généralement limitée
de matière et d’énergie. En outre la dynamique auto-croissante
de la réciprocité, le surplus de bien-vivre qui se génère
à travers le partage est le seul procesus qui permet au niveau individuel
de contraster les motivations profondes (angoisse, aliénation) qui
sont à la base de l’inexorable tendance à l’augmentation
de la consommation. Sans une forte motivation et le soutien réciproque
du réseau, les initiatives tendant à défendre l’environnement,
la consommation critique, la finance éthique, etc, risquent de rester
de expressions stériles.
Quant aux phénomènes d’exploitation, la tertiairisation
sauvage, le dumping social et environnemental, jusqu’à la diffusion
de véritables formes d’économie illégale, nous
avons démontré qu’ils sont dus aux dynamiques de la sélection
intraspécifique déclenchées par les excès compétitifs
de l’économie globale. Il est évident que contre ces comportements
déviants, la société civile prévoit depuis toujours
des formes de contrôle mais elles ne sont pas efficaces. Dans ce cas
également une réflexion plus approfondie s’impose. Elle
devrait pouvoir remettre en discussion les caractéristiques optimalisantes
associées en particulier aux formes de marché fortement concurrentielles
qui caractérisent l’économie globale en proposant une
nouvelle manière de considérer les marchés. La perspective
bioéconomique illumine différemment la théorie des formes
de marché.
Elle démontre que le comportement optimal pour les sujets qui opèrent
sur le marché ne vient pas de la maximisation des attitudes compétitives
mais plutôt de la présence complémentaire d’attitudes
compétitives et coopératives, dans une proportion qui différera
selon la morphologie du contexte. Voilà que l’approche bioéconomique
appelle le développement d’une morphologie de l’entreprise
et du marché, comme la biologie a développé une anatomie
(et une anatomie pathologique!) du monde animal et végétal.
Cet art taxinomique, descriptif appliqué à l’univers économique
est probablement ce que Marshall imaginait quand il parlait de la biologie
comme de la Mecque de la science économique. Certes, il a fallu découvrir
d’abord les lois de la physique classique avec leur caractère
universel, puis les sciences naturelles ont connu elles aussi l’ère
de la thermodynamique et de la biologie avec leur bagage d’évolution,
diversité, qualité et description.
La première conclusion est que les typologies de marché les
plus aptes à maintenir les équilibres écologiques et
sociaux ne sont pas celles où la concurrence est poussée au
maximum (concurrence parfaite) ni celles où la concurrence est au minimum.
(marchés oligopolistiques dominés par les grandes entreprises
trans-nationales). En effet les formes de marché intermédiaires
permettent d’une part, à des organisation de petites dimensions
(donc potentiellement conviviales) de disposer de marges plus amples par rapport
aux marchés parfaitement concurrentiels (leur consentant ainsi de correspondre
des salaires plus élevés et de recourir à l’outsourcing
de façon plus limitée), et d’autre part d'éviter
la fourchette des revenus caractéristique des marchés dominés
par les grandes entreprises trans-nationales. Ces formes de marché
pourraient être stimulées par une différenciation importante
du produit, obtenue non pas à travers les instruments publicitaires
traditionnels, mais à travers la création d'organisations qualitativement
différentes. L’on sait que certaines zones d’Europe et
de la Méditerranée en particulier sont déja caractériseées
par un type de structure économique fortement diversifiée. Les
moyens de pratiquer cette différenciation sont nombreux: Il s'agira,
par exemple, d'immaginer et de realiser de nouvelles institutions et organisations
productives, petites et conviviales, de nouvelles relations de travail solidaires
et participatives, de nouvelles façons de produire écologiquement
soutenables, d'offrir des biens ou services “locaux” liés
à un territoire déterminé en tant qu’expression
d’une certaine culture ou tradition ou, enfin, des produits non standardisés
de haut contenu de connaissance/information. Créer, en somme, un monde
riche en qualité et diversité qui, comme nous l’enseignent
les sciences de la vie, est le seul contexte dans lequel un certain degré
de compétition devient véhicule de richesse ultérieure
et non la cause de l’aplatissement global et de la destruction réciproque.
______
*Université de Modena, Italie, e-mail: pet7407@iperbole.bologna.it
« Celui qui
croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Kenneth Boulding (1910-1993), président de l'American Economic Association.
Bêtisier du développement durable
Les textes et visuels de decroissance.org ne peuvent être reproduits sans autorisation préalable.